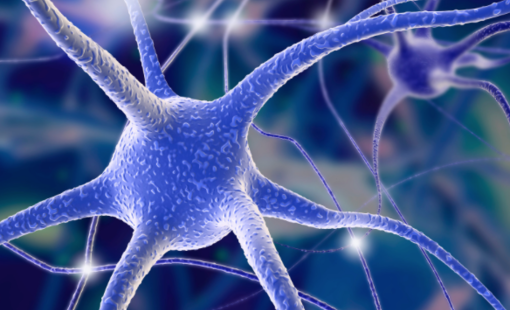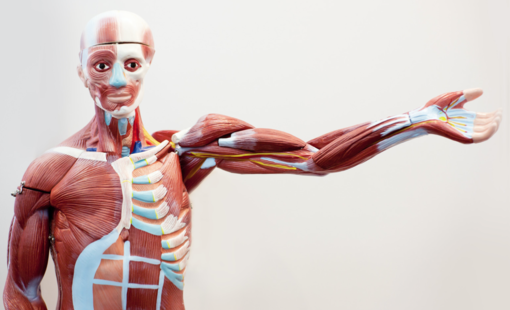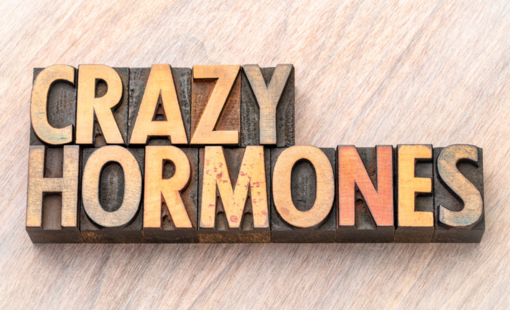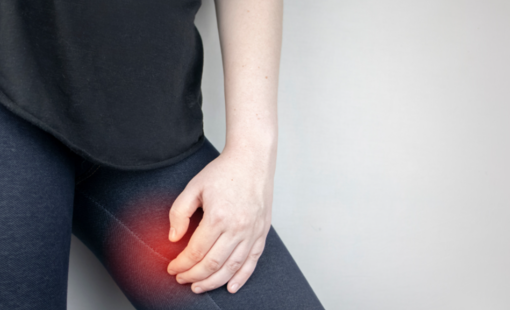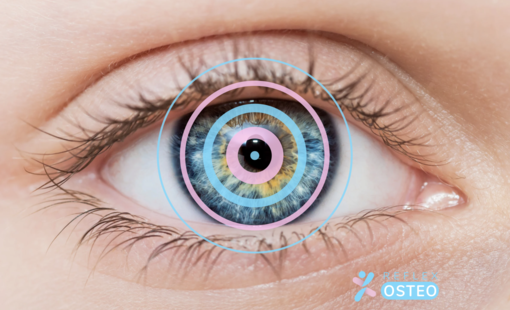Faut-il coter les actes d'ostéopathie ?

Alors que la profession de masseur-kinésithérapeute s’appuie depuis longtemps sur une nomenclature codifiée (AMK, NGAP) pour la cotation de ses actes, l’ostéopathie en France continue d’évoluer dans un flou administratif partiel. Aucun code, aucun barème, aucune nomenclature ne vient aujourd’hui baliser la pratique de l'ostéopathie, même si celle-ci est reconnue par la loi depuis 2002. Cette situation pose une question essentielle, de plus en plus soulevée : faut-il coter les actes d'ostéopathie ?
Un contexte différent de celui des kinésithérapeutes
La kinésithérapie, à travers la nomenclature AMK (Aide à la Mobilité et aux Kinésithérapeutes) et la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels), permet une cotation des actes AMK en kinésithérapie : rééducation, bilan, techniques respiratoires, travail neuromusculaire... Chaque acte possède un code, une valeur, une majoration éventuelle. Cela facilite :
- le remboursement par l’Assurance Maladie,
- la traçabilité et la standardisation des pratiques,
- la communication interprofessionnelle,
- la reconnaissance médicale des actes effectués.
L’ostéopathie, en revanche, ne bénéficie d’aucun tel système. Chaque ostéopathe fixe librement ses honoraires, déclare l’objet de sa consultation sans standardisation, et travaille hors du champ de remboursement de la Sécurité Sociale (exceptés les remboursements mutuelle).
Les avantages d'une cotation
1. Renforcer la reconnaissance institutionnelle
Comme le souligne Pierre-Luc L'Hermite, enseignant-chercheur en ostéopathie et doctorant en philosophie des sciences, une intégration de l’ostéopathie dans une nomenclature standardisée permettrait d'établir un langage commun avec les autres professions de santé. Cela irait dans le sens d’une meilleure reconnaissance de la discipline par les institutions publiques.
2. Progresser vers une ostéopathie fondée sur les preuves
Pierre-Luc L’Hermite plaide pour une ostéopathie moderne, compatible avec les exigences de la médecine fondée sur les preuves. Une nomenclature inciterait les ostéopathes à définir précisément leurs actes, leurs objectifs, et les résultats attendus. Elle pourrait aussi favoriser la recherche clinique et l'évaluation de l’efficacité des techniques.
3. Faciliter les remboursements mutuelle
Actuellement, les remboursements par les mutuelles sont fondés sur un système forfaitaire flou (X séances par an, X euros). Une cotation des actes permettrait aux mutuelles de mettre en place des remboursements différenciés selon la nature des soins, renforçant la lisibilité pour les patients.
4. Proposer des actes sur prescription
La cotation pourrait également ouvrir la voie à une ostéopathie sur prescription médicale dans certains contextes spécifiques (par exemple, en post-chirurgie ou en médecine du sport), comme c’est déjà le cas pour les kinésithérapeutes.
Les risques d'une cotation
1. Perte d'autonomie
Pour de nombreux ostéopathes, la liberté de pratique est un pilier fondateur. Une codification trop rigide des actes pourrait entraîner une perte d’autonomie, une uniformisation des soins, voire une entrave à l’approche globale et adaptative chère à la profession.
2. Bureaucratisation de la pratique
La mise en place d’une nomenclature implique inévitablement une charge administrative accrue : codage, facturation, reporting. Cela pourrait éloigner les praticiens de leur cœur de métier : le soin et l’observation clinique.
3. Une difficulté à définir des actes standards
L’ostéopathie repose sur une analyse individualisée de chaque patient. Il est donc difficile de créer des catégories d’actes précis, comme le fait l’AMK pour les kinésithérapeutes. Le risque serait de réduire la richesse et la variabilité de la pratique à des cases normatives.
Quelles alternatives ?
→ Une nomenclature souple ?
On pourrait envisager une nomenclature propre à l’ostéopathie, mais construite par la profession elle-même, avec l’aide de chercheurs comme Pierre-Luc L’Hermite. Cette nomenclature pourrait reposer sur des actes types (bilan, travail articulaire, viscéral, crânien...) sans figer les approches.
→ Une cotation volontaire, non imposée ?
Une autre voie serait de proposer un système de cotation facultatif, utilisable par les ostéopathes qui souhaitent communiquer plus précisément avec les autres professionnels de santé ou les assureurs.
→ Intégration progressive dans les parcours de soins ?
Plutôt qu’une intégration massive à la NGAP, une stratégie d’étapes pourrait être mise en place :
- d’abord via la formation, en sensibilisant les ostéopathes à la logique de traçabilité et de preuve,
- ensuite en menant des études cliniques sur des actes standardisés,
- enfin en dialoguant avec les institutions de santé.
Conclusion
La question de la cotation des actes d’ostéopathie renvoie à un enjeu plus large : celui de la professionnalisation et de la structuration de l'ostéopathie en France. Si une nomenclature standardisée permettrait une meilleure reconnaissance et une communication renforcée avec les autres professions, elle comporte également le risque d’uniformiser une pratique historiquement holistique et adaptative.
Il ne s’agit pas d’imposer une cotation, mais d’ouvrir le débat, d’imaginer des alternatives, et de favoriser l’émergence d’une ostéopathie plus lisible, plus démontrable et plus connectée à son environnement médico-social.
Et si la cotation était une opportunité, plutôt qu’une contrainte ?
et votre éventuelle expérience avec l’ostéopathie !
Temoignages
Votre expérience est précieuse ! Partagez-là avec notre communauté de plus de 207564 patients.
Racontez nous votre parcours thérapeutique, vos symptômes, et votre éventuelle expérience avec l’ostéopathie !